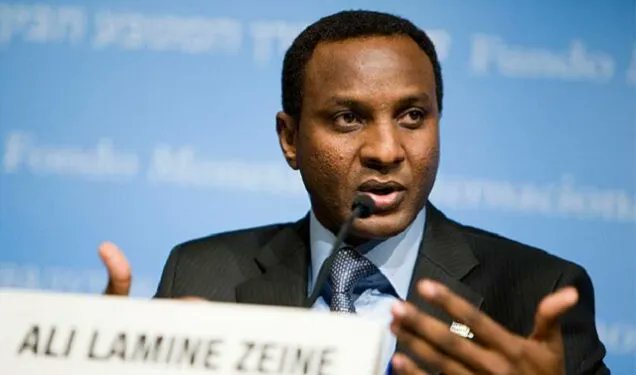Beaucoup cherchent à savoir l’issue judiciaire de Félicien Kabuga, le présumé financier du génocide rwandais arrêté après 23 ans de fuite. Cette issue judiciaire est tributaire de la capacité de la justice internationale à se dépasser.
Après l’arrestation retentissante en France, du financier présumé du génocide au Rwanda, Félicien Kabuga, et la confirmation du décès de l’ex-ministre de la Défense, Augustin Bizimana, il ne reste plus qu’un seul grand fugitif sur la liste du Mécanisme héritier du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) : le major Protais Mpiranya, qui commandait la garde du président Juvénal Habyarimana.
Le Rwanda a hérité du dossier de cinq autres « petits poissons » accusés par le TPIR et restant en fuite après les 21 ans d’existence du tribunal d’Arusha (Tanzanie), qui a jusqu’à présent jugé 73 individus pour leur participation au génocide des Tutsi de 1994.
Fort du succès de l’arrestation de Kabuga, Serge Brammertz, vétéran des tribunaux internationaux et candidat sérieux à la succession de Fatou Bensouda à la Cour pénale internationale, va faire feu de tout bois pour que le dernier des « gros poissons » du TPIR soit arrêté.
Le bureau du procureur du Mécanisme assure qu’il « continue de rechercher activement » Mpiranya. L’homme avait été signalé il y a quelques années au Zimbabwe. Et le 11 décembre dernier, devant le Conseil de sécurité, Brammertz accusait, pour la deuxième fois, l’Afrique du Sud d’avoir fait obstacle à l’exécution d’« un mandat d’arrêt délivré de longue date » à contre un fugitif dont l’identité n’est pas dévoilée. S’il s’agit de Mpiranya, le sexagénaire, à condition que les mesures barrières restreignant les mouvements dues au Coronavirus, le permettent, doit être en train de chercher les moyens de ne pas rejoindre en cellule Kabuga, dont le Mécanisme a demandé le transfert à La Haye.
Ce « Mécanisme », qui s’occupe des « fonctions résiduelles » des anciens tribunaux internationaux pour le Rwanda et pour l’ex-Yougoslavie, dispose de bureaux en Tanzanie et aux Pays-Bas. En demandant son transfert à La Haye, le procureur tente d’obtenir une remise rapide de Kabuga et de prévenir l’opposition de la défense de l’ex-fugitif à un transfert vers Arusha pendant la pandémie du Coronavirus.
Dans l’ordre normal des choses, devra être jugé à Arusha en Tanzanie dont la mission première est de rechercher et de juger les accusés du TPIR en cabale.
Suite aux félicitations adressées au Mécanisme et à l’Office français de lutte contre les crimes contre l’humanité pour avoir mis fin à la plus longue cavale de la justice internationale contemporaine, plusieurs questions se posent sur les protections dont Kabuga aurait bénéficié et sur les faiblesses symptomatiques du tribunal onusien qu’il a défié pendant un quart de siècle.
Mais une autre question, jusqu’à présent, est restée sans réponse. La question est de savoir si Kabuga sera effectivement jugé et éventuellement condamné, compte tenu de son âge très avancé, par la justice internationale vu la lenteur que connaissent les dossiers devant cette justice.
Ayant comparu en fauteuil roulant devant les juges à Paris le 20 mai dernier, Kabuga a rectifié être âgé de 87 et non 84 ans comme mentionné dans son mandat d’arrêt. Les avocats de l’homme ont brandi sa mauvaise santé en vue d’aller contre son transfert devant la justice internationale. Ils ont demandé qu’il soit jugé en France.
Dans le livre des records du tribunal d’Arusha figure le procès du colonel Théoneste Bagosora, célèbre pour avoir été accusé d’être un « cerveau » du génocide. Arrêté en mars 1996 au Cameroun, il ne sera condamné définitivement, en appel, que près de 15 ans plus tard, en décembre 2011.
Sur des procès « rapides » il y a celui d’Augustin Ngirabatware, le gendre de Kabuga. L’ancien ministre du Plan, arrêté en septembre 2007 en Allemagne, sera condamné sept ans plus tard, en appel, dans un dossier dont la complexité fait pâle figure face à celui d’un Kabuga – dans lequel l’accusation va devoir établir, pour la première fois dans l’histoire du TPIR, la responsabilité criminelle d’un financier dans la commission du génocide. Son acte d’accusation ne compte pas moins de sept charges de génocide et de crimes contre l’humanité, et sa défense, légitimement, ne manquera pas de demander à effectuer ses propres investigations.
À la durée « normale » d’un procès devant une juridiction pénale internationale vient s’ajouter la nécessité, dans le cas du Mécanisme, de remettre en route une mécanique onusienne en plein sommeil. L’hypothèse alternative d’un procès devant la justice française, tel que l’a demandé Kabuga, se heurterait, elle, à la complexité de transférer des enquêtes réalisées par un TPIR marqué par la procédure de common law, devant un juge d’instruction français.
Deux affaires ont été transférées, en 2007, du tribunal d’Arusha vers la justice française, dans le cadre de la stratégie dite « d’achèvement » des travaux du TPIR. L’une – celle du père Wenceslas Munyeshyaka – a fait l’objet d’un non-lieu en 2019. L’autre – celle de l’ancien préfet Laurent Bucyibaruta – a été renvoyée en assises, pour un procès désormais attendu pour 2021.
Une hypothèse raisonnablement viable, bien que théorique, pour qu’un jugement soit prononcé dans l’affaire Kabuga avant qu’il ne fête ses 90 ans, serait qu’il entre dans un plaidoyer de culpabilité et passe un accord avec le procureur. Mais à notre connaissance, cette option n’est à l’heure actuelle envisagée par aucune des deux parties.
De la capacité de la justice internationale à se dépasser autant que de l’espérance de vie de l’accusé, l’issue judiciaire de cette histoire extraordinaire va assurément dépendre. Et à ce jour, force est de simplement constater que personne de responsable et de convaincant n’est en mesure de garantir que les jugements derniers du TPIR – celui de Kabuga et de Mpiranya – seront, pour des raisons différentes, effectivement rendus.



 InternationaleIl y a 4 ans
InternationaleIl y a 4 ans
 CitoyennetéIl y a 5 ans
CitoyennetéIl y a 5 ans
 SocieteIl y a 5 ans
SocieteIl y a 5 ans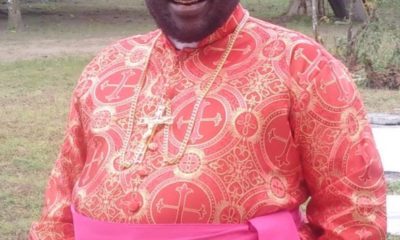
 SocieteIl y a 3 ans
SocieteIl y a 3 ans
 NationaleIl y a 4 ans
NationaleIl y a 4 ans
 NationaleIl y a 5 ans
NationaleIl y a 5 ans
 NationaleIl y a 4 ans
NationaleIl y a 4 ans
 EnvironnementIl y a 6 ans
EnvironnementIl y a 6 ans